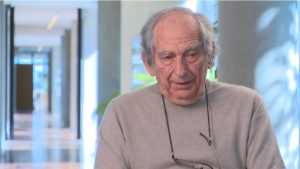 La médecine déclare de façon récurrente depuis plus d’un siècle que le problème posé par le cancer du sein est en voie d’être réglé.
La médecine déclare de façon récurrente depuis plus d’un siècle que le problème posé par le cancer du sein est en voie d’être réglé.
En 1894, Halsted, un chirurgien nord américain de renom, a prétendu être en mesure de guérir le cancer du sein grâce à une intervention qui porte son nom.
Pour être sûr d’être efficace, il retirait la totalité du sein atteint, les plans musculaires sous jacents et l’ensemble des chaînes ganglionnaires drainant le sein. Selon lui, il fallait anticiper une éventuelle extension de la maladie, laquelle était perçue comme évoluant progressivement, de façon linéaire dans le temps, par étapes successives inéluctables. Elle était d’abord locale puis se généralisait avec des métastases qui conduisaient à la mort. Il fallait interrompre le plus tôt possible ce mécanisme infernal, ce qui justifiait cette véritable mutilation. Son intervention n’était pas nouvelle, l’ablation du sein était pratiquée depuis l’Antiquité et, au XVIIIème siècle, Bernard Peyrilhe préconisait déjà une chirurgie extensive avec ablation du muscle pectoral et des ganglions de l’aisselle. Halsted a amélioré la technique. Avant lui, les patientes mourraient très souvent des suites de l’intervention et l’on ne pouvait pas juger de l’efficacité de celle-ci. Avec Halsted et les progrès de l’asepsie et de l’anesthésie, les patientes survivent plus longtemps, ce qui permet d’apprécier l’effet de la chirurgie sur l’évolution de la maladie.
Ainsi pour Halsted, la taille de la tumeur au moment du diagnostic et l’étendue de l’exérèse conditionnent le pronostic, petit égale précoce et précoce égale curable. On postule l’existence d’une phase suffisamment longue pendant laquelle il serait possible de guérir la maladie.
Tout retard de diagnostic porte préjudice à la patiente.
Le sein est pour ce schéma l’organe idéal, un modèle pur en cancérologie. En effet c’est un organe externe, non vital, susceptible d’une ablation totale, accessible à la vue et au toucher, pour lequel le diagnostic de petites tumeurs est possible. Tous les ingrédients sont apparemment réunis pour que les femmes ne meurent plus prématurément d’un cancer du sein.
Or contrairement aux affirmations d’Halsted son intervention a été un échec.
Elle ne donne pas de meilleurs résultats qu’une chirurgie conservatrice et la mortalité par cancer du sein n’a cessé de croître en France jusqu’aux années 90 malgré les « progrès de la thérapeutique » qu’ont été la radiothérapie, la chimiothérapie et bien que la taille des tumeurs ait diminué régulièrement à partir des années 70.
Au lieu de rechercher les causes de cet échec, de remettre en question cette conception linéaire par étapes de la maladie, nous avons persisté dans l’erreur en adaptant nos pratiques avec une chirurgie plus conservatrice mais en gardant le même schéma théorique de l’histoire naturelle de la maladie :
C’est dans ce contexte qu’intervient la mammographie dans les années 50/60.
Elle apparaît comme l’outil idéal dans cette conception. Elle donne l’espoir d’accéder au diagnostic de tumeurs avant qu’elles n’aient une expression clinique. En l’absence d’une prévention primaire connue et en raison de la grande fréquence de cette maladie, l’idée d’un dépistage de masse organisé fait son chemin.
La maladie cancéreuse est réduite à une image.
Avec la mammographie, le monde médical crie à nouveau victoire. « Cette femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie »
Il n’y a plus qu’à …. Le dépistage de masse organisé devient une réalité.
Les résultats ne se sont pas fait attendre.
Dès 2000, la Cochrane, un organisme indépendant d’expertise médicale, montre que, contre toute attente, le fait de dépister ne permet pas de diminuer sensiblement la mortalité.
A ce constat s’ajoute le fait que les formes évoluées de cancer du sein ne diminuent pas, le nombre des mastectomies totales non plus.
Dans le même temps, on observe également le diagnostic d’une efflorescence de cancers in situ, soi-disant la forme la plus précoce du cancer, sans pour autant que le nombre de cancers invasifs baisse.
L’échec est total, rien ne s’est produit comme prévu. Pire, le dépistage, au lieu de régler le problème, le complique.
Le dépistage s’accompagne d’une augmentation du nombre de cancers diagnostiqués. Dans un premier temps, à sa mise en place, c’est normal car on anticipe ainsi le diagnostic de cancers qui se seraient manifestés ultérieurement. Mais ensuite, logiquement, le nombre de cancers dépistés devrait se stabiliser or il continue d’augmenter. Par ailleurs, après quelques années de dépistage, la comparaison entre population dépistée et non dépistée montre toujours un excès de cancers dans la population dépistée par rapport à la population non dépistée.
Ces cancers en excès sont des cancers qui, s’ils n’avaient pas été diagnostiqués, n’auraient causé aucun inconvénient à la femme. C’est ce qu’on appelle le surdiagnostic.
Le dépistage du cancer du sein génère de la maladie chez des femmes bien-portantes, ce qui est un comble pour une opération de santé publique.
Ce concept est étayé par le résultat d’autopsies systématiques ou d’interventions de réduction mammaire à but esthétique. La proportion de femmes porteuses de cancers asymptomatiques y est beaucoup plus importante que prévu.
Si le dépistage n’a pas fait la preuve de son efficacité, ses effets délétères sont bien là.
Les cancers surdiagnostiqués engendrent un surtraitement intolérable du fait des effets secondaires majeurs qu’ils peuvent occasionner.
Ils augmentent aussi le nombre de femmes considérées comme étant à risque ainsi que leur descendance conduisant à une pléthore de mammographies elles-mêmes susceptibles par leur nombre chez des femmes de plus en plus jeunes d’induire des cancers du sein. Le dépistage s’autoalimente.
Le surdiagnostic est par ailleurs pourvoyeur d’illusions. C’est parce qu’il est plus fréquent parmi les petites tumeurs sans envahissement ganglionnaire qu’il donne l’illusion de l’efficacité d’un diagnostic précoce, du dépistage et des traitements.
Une fois admis, il permet de comprendre pourquoi, alors qu’on diagnostique des lésions cancéreuses de plus en plus petites, la mortalité ne baisse pas sensiblement avec le dépistage. Et lorsqu’on observe une baisse, elle est identique chez les femmes dépistées et non dépistées.
Quand on a pris conscience de l’existence du concept de surdiagnostic, c’est à dire du diagnostic de cancers histologiquement prouvés mais inoffensifs, alors on comprend que la définition purement histologique ne suffit plus pour définir la maladie cancéreuse potentiellement mortelle.
De nouveaux paradigmes sont nécessaires pour construire une nouvelle théorie de l’histoire naturelle de la maladie qui soit plus proche de la réalité.
Au total, il faut mettre en parallèle bénéfices et inconvénients du dépistage.
Dans le meilleur des cas, admettre une réduction de 15 à 20 % du risque relatif de mourir d’un cancer du sein chez les femmes qui se font dépister revient à un gain en risque absolu de 0,05 %. Ce gain minime aura été obtenu au prix d’une augmentation considérable des biopsies négatives, de traitements potentiellement létaux inutiles, d’alertes anxiogènes. Si on regarde maintenant la mortalité globale qui inclut toutes les causes de décès, le gain dû au dépistage est réduit à néant.
Parmi les informations pour un choix éclairé à donner aux femmes, l’information cruciale est qu’on les invite à une opération de santé publique qui n’a pas fait la preuve de son efficacité. Or une opération de santé publique a une obligation de résultats vis à vis de la population ciblée.
On marche sur la tête quand les pouvoirs publics en sont à inviter les femmes à une concertation citoyenne pour savoir s’il faut continuer le dépistage, alors qu’ils ont déjà légiféré et organisé ce dépistage.
Aujourd’hui le problème n’est plus de démontrer l’inefficacité du dépistage.
Il s’agit de comprendre pourquoi cela ne marche pas. Le cancer du sein n’obéit pas aux règles qui lui ont été prescrites par la médecine et depuis plus d’un siècle on se refuse à en tirer les leçons.
Bernard Duperray
À lire Dépistage du cancer du sein – La grande illusion
À regarder Cancer du sein : le dépistage généralisé est-il un échec ?


@ ESSAYARI Hafez : Votre commentaire paraît juste , mais vous qui suivez ce site , avez sauté quelques quelque articles dont celui ci, du même Médecin :
Le surdiagnostic, par Dr Bernard Duperray7 février 2017Dans « Médias »
que vous pourrez ouvrir dans le articles cités ci-dessus et donnent une vingtaine de liens d’études qui répondront à votre inquiétude.
Bonne lecture.
Bonjour
Il aurait été judicieux que l’auteur de l’article se présente au lieu de signer simplement de son nom : nous ne sommes pas obligés de savoir qu’il est médecin, spécialiste du cancer du sein, farouche opposant au dépistage. Cela aurait au moins permis de savoir que ce Monsieur s’est forgé sa conviction en connaissance de cause. Le commentaire « coup de gueule » de ESSAYARI Hafez. est donc tout à fait justifié et opportun.
Cela dit, le débat est identique autour du cancer de la prostate. Avec une bataille « intranchable » entre les « pour » et les « contre » le dépistage. Sur ce cancer de la prostate (pardon de ne pas rester sur le cancer du sein mais les deux causes sont assez similaires, il me semble), la seule chose dont je puisse témoigner à titre personnel – étant membre d’une association de malades et ayant noué des liens amicaux avec certains « malades » – c’est que je connais non pas un, mais plusieurs hommes, dépistés et diagnostiqués, soit par mesure de PSA (pas fiable quand même…) soit par toucher rectal, qui sont toujours en vie après plusieurs années et, le plus important, en pleine forme. Mon mari a demandé à son médecin le dépistage alors qu’il n’avait aucun symptôme, par simple précaution.Son médecin lui a répondu « non, cela ne se fait plus systématiquement et cela ne sert à rien ». Mon mari a vérifié l’information, à ma demande, auprès de son frère, professeur de médecine, qui lui a répondu la même chose. Lorsque les symptômes sont apparus, il était trop tard et il n’a survécu que quelques mois.
Naturellement, on ne peut nier le « surdiagnostic » et les mini-tumeurs traitées alors qu’elles n’auraient pas évolué ou qu’elles auraient spontanément régressé…Mais, c’est aux urologues à mieux se former pour savoir quand il faut traiter et quand il faut simplement proposer une « surveillance active » en lieu et place d’un traitement anticancéreux. Est-ce que cela ne peut pas se proposer de la même manière pour le cancer du sein ?
Cordialement
Beaucoup d’affirmations fortes, beaucoup de chiffres et de statistiques supposés, mais il nous faut pouvoir vérifier toutes ces données et apparemment l’auteur de l’article est tellement sûr de lui, de ses connaissances ou de ses croyances, qu’il omet de nous donner une quelconque source qui permettrait un tant soit peu, dans une attitude rationnelle, de vérifier tout ce qui est affirmé péremptoirement !Nous ne sommes pas des moutons à brouter une herbe factice fut elle d’apparence verdoyante et prometteuse de satisfactions singulières, nous ne sommes pas des vaches à traire généreusement sans êtres nourries de bonne et consistante nourriture, nous sommes juste des lecteurs et lectrices qui méritent qu’on leur donnent les moyens de savoir de quoi est composée la connaissance et le savoir qu’on leur offre si généreusement de consommer les yeux bandés !
Des chiffres avec des sources claires et vérifiables, dès démonstrations vraies avec toutes leurs étapes, qu’on puisse suivre pas à pas, de grâce ! Merci !
« Ce gain minime aura été obtenu au prix d’une augmentation considérable des biopsies négatives, de traitements potentiellement létaux inutiles, d’alertes anxiogènes. »
ô combien ça me parle cette phrase là !!!!!
Par trois fois des biopsies avec toutes les angoisses qui vont avec… pour rien du tout …. heureusement mais enfin tout ce stress inutile !
Maintenant pour moi tout cela est terminé ! Aski ! comme on dit chez nous. Je reste à l’écoute de mon corps tout simplement et si je sens que quelque chose ne va pas j’irai consulter…
Merci pour cet article très intéressant et très instructif…
Bonne soirée à toutes et à tous
Coco